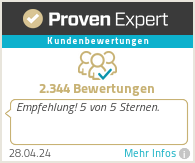Vu de loin, l'œuvre de Louis-François Lejeune ressemble en grande partie à une chronologie des campagnes de Napoléon Bonaparte, et en y regardant de plus près, le lien avec sa biographie apparaît. Né à Strasbourg dans la France absolutiste, il s'intéresse rapidement à l'art, influencé par son père musicien. C'est ainsi qu'il a suivi la formation d'artiste de Pierre-Henri de Valenciennes à Paris. La Révolution française, qui se propagea ensuite principalement dans la capitale française, marqua cependant peu après un tournant dans sa vie, lorsqu'il rejoignit les révolutionnaires à l'âge de dix-sept ans et se tourna vers une carrière militaire. A partir de ce moment, sa vie se déroule entre l'art et la guerre, il est loué et reconnu en tant que peintre, il gravit rapidement les échelons de l'armée française du nouvel empereur Napoléon, devient adjudant, capitaine et enfin officier. En guise de reconnaissance, Napoléon l'anoblit. Il assista également aux revers de l'armée en Russie, fut blessé et quitta l'armée en 1813, un an avant la fin de la guerre et la défaite finale de la France.
Lejeune a transposé ses expériences lors des nombreux combats dans ses tableaux, qui étaient également très appréciés par Napoléon lui-même ; on y trouve notamment des représentations des batailles de Marengo, Austerlitz et Somosierra. En tant qu'œuvres d'un témoin oculaire, les tableaux offrent un point de vue rare et permettent en outre de déduire la vision de l'artiste. Ainsi, les soldats français sont représentés de manière plus positive que leurs ennemis, qui fuient souvent devant l'assaut des troupes de Napoléon. L'empereur lui-même est également transfiguré, on le retrouve souvent au centre des tableaux, un chef militaire souverain, sûr de lui et calme dans le tumulte des combats. Lejeune livre une représentation romancée des guerres napoléoniennes et montre son rôle de défenseur convaincu des idées de l'Empereur : il n'est pas étonnant que Napoléon l'ait apprécié non seulement pour son engagement dans la guerre, mais aussi pour ses œuvres d'art.
Mais la fin du règne de Napoléon n'a pas entamé la réputation de Louis Lejeune. Il s'engagea à nouveau dans l'armée sous le roi Louis XVIII, reçut de nombreuses décorations et épousa la fille d'un général. Lejeune connut une autre gloire, celle d'avoir fait connaître en France la technique de la lithographie, nouvelle à l'époque, lorsqu'il apprit l'existence de cette technique d'impression à Munich auprès de l'inventeur Alois Senefelder. L'histoire ne dit pas si cette renommée est justifiée, mais Lejeune en profita bien sûr, publia ses mémoires qui furent accueillies avec enthousiasme et, à Toulouse, il devint directeur d'une école d'art et finalement maire. Louis Lejeune, qui avait combattu tant de batailles et survécu à tant de blessures, mourut d'une crise cardiaque à l'âge de 73 ans.
×





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(7_September_1812)_(oil_on_canvas_-_(MeisterDrucke-951049).jpg)
_(7_September_1812)_(oil_on_canvas_-_(MeisterDrucke-951049).jpg)
 - (MeisterDrucke-39410).jpg)
 - (MeisterDrucke-39410).jpg)
.jpg)
.jpg)
 Visiting a Bivouac on the Eve of the Battle of Austerlitz 1st December 1805 1808 - (MeisterDrucke-113063).jpg)
 Visiting a Bivouac on the Eve of the Battle of Austerlitz 1st December 1805 1808 - (MeisterDrucke-113063).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 and his Major 1801 (see also 28336) - (MeisterDrucke-57383).jpg)
 and his Major 1801 (see also 28336) - (MeisterDrucke-57383).jpg)
 and his staff c1804 - (MeisterDrucke-61522).jpg)
 and his staff c1804 - (MeisterDrucke-61522).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1661866).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1661866).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1663693).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1663693).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660927).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660927).jpg)
 and his Major 1801 (detail of 153773) - (MeisterDrucke-54316).jpg)
 and his Major 1801 (detail of 153773) - (MeisterDrucke-54316).jpg)
_Battle_of_Chiclana_near_C_-_(MeisterDrucke-971002).jpg)
_Battle_of_Chiclana_near_C_-_(MeisterDrucke-971002).jpg)
 - (MeisterDrucke-68132).jpg)
 - (MeisterDrucke-68132).jpg)
 Tending the Wounded - (MeisterDrucke-216996).jpg)
 Tending the Wounded - (MeisterDrucke-216996).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1663691).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1663691).jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1661861).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1661861).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660928).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660928).jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660033).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660033).jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660929).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660929).jpg)
.jpg)
.jpg)
_of_Egypt_(1798-1801)_The_Battle_of_Aboukir_(July_25_-_(MeisterDrucke-960795).jpg)
_of_Egypt_(1798-1801)_The_Battle_of_Aboukir_(July_25_-_(MeisterDrucke-960795).jpg)
 Giving Orders at the Battle of Lodi 10th May 1796 c1804 - (MeisterDrucke-69694).jpg)
 Giving Orders at the Battle of Lodi 10th May 1796 c1804 - (MeisterDrucke-69694).jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1661155).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1661155).jpg)
 - (MeisterDrucke-41522).jpg)
 - (MeisterDrucke-41522).jpg)
 - (MeisterDrucke-40168).jpg)
 - (MeisterDrucke-40168).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660053).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660053).jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1661867).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1661867).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660926).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660926).jpg)
.jpg)
.jpg)
_the_Battle_of_Somosierra_the_30111808_Painting_b_-_(MeisterDrucke-948221).jpg)
_the_Battle_of_Somosierra_the_30111808_Painting_b_-_(MeisterDrucke-948221).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660918).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660918).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660931).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660931).jpg)
_of_Egypt_(1798-1801)_Battle_of_Mount_Thabor_April_16_-_(MeisterDrucke-1023410).jpg)
_of_Egypt_(1798-1801)_Battle_of_Mount_Thabor_April_16_-_(MeisterDrucke-1023410).jpg)
_of_Egypt_(1798-1801)_The_Battle_of_the_Pyramids_July_21_-_(MeisterDrucke-1029401).jpg)
_of_Egypt_(1798-1801)_The_Battle_of_the_Pyramids_July_21_-_(MeisterDrucke-1029401).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1427987).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1427987).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660057).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660057).jpg)
_assault_of_the_monastery_of_San_Engraci_-_(MeisterDrucke-1021467).jpg)
_assault_of_the_monastery_of_San_Engraci_-_(MeisterDrucke-1021467).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1661862).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1661862).jpg)
_of_Egypt_(1798-1801)_The_Battle_of_the_Pyramids_July_21_-_(MeisterDrucke-1029403).jpg)
_of_Egypt_(1798-1801)_The_Battle_of_the_Pyramids_July_21_-_(MeisterDrucke-1029403).jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660930).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1660930).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1628313).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1628313).jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1663682).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1663682).jpg)